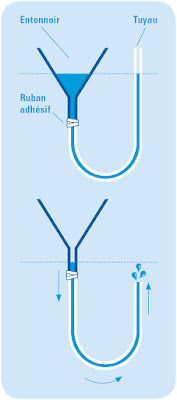La
transition énergétique
Une
nécessaire mise à jour
Depuis mes articles de 2019
sur ce sujeten évolution rapide, des
nouveautés se font jour au rythme d'une annonce majeure pratiquement chaque semaine.
Ainsi, parmi les événements les plus pertinents de ces dernières années:
-
l'irruption
de la pandémie du COVID dans la problématique d'ensemble et l'écroulement, en
2020, des productions et consommations d'énergie tant au plan national qu'aux
plans européen et mondial
-
le
déclenchement de la guerre en Ukraine et son impact sur l'évolution du mix
énergétique à partir de 2022
-
un retournement assez spectaculaire de
l'Exécutif français sur la place qu'il convient de réserver à
l'électronucléaire dans la réindustrialisassions du pays, confortant en cela
nos premières conclusions sur le sujet
-
l'édition
par l'organisme Réseau de Transport Electrique (RTE)
d'une étude prospective
sur le mix énergétique national à l'horizon 2050, et intégrant en particulier
la décision prise au niveau de l'UE d'arrêter la production de "véhicules
thermiques" dès 2035 – une première
étape vers un monde "tout électrique"?
-
la
présentation de l'hydrogène comme solution magique au problème des énergies
renouvelables, dernier buzz word médiatique dont il convient d'analyser
la pertinence au regard des possibilités intrinsèques de ce vecteur
d'énergie
De plus, et s'agissant précisément
des énergies renouvelables, il convient de faire un nouveau point sur les
mérites relatifs de ces énergies en intégrant la progression constatée des énergies
renouvelables électriques –
et les problèmes de stockage d'énergie posés par ces énergies fatales –
ainsi que les limites quantitatives attendues des énergies renouvelables
thermiques, tout particulièrement de la biomasse.
Et en final, montrer en quoi
la stratégie nationale doit être adaptée pour satisfaire ce qui reste
l'objectif premier de toute transition énergétique: sortir les énergies
fossiles du mix énergétique afin de garantir une moindre évolution du climat
compatible avec la vie sur Terre d'ici la fin du siècle.
1. où le monde
d'après COVID ressemble au "monde d'avant"
La figure 1 illustre le bilan
énergétique de la France
en 2021, année de reprise économique après la pandémie ayant conduit au
confinement de 2020.
Fig.1 Bilan énergétique de la France pour 2021
1ère remarque:
Les quantités d'énergie sont
à présent exprimées en térawatt-heures
(TWh) et non plus en millions de tonnes-équivalent pétrole (MTep). Néanmoins le
lecteur assidu ne sera pas déstabilisé car il a appris
que:
1Mtep = 11,63 TWh
Par la suite on utilisera
indifféremment l'une ou l'autre unité sachant que le TWh sera plus pertinent au
regard de la mesure d'une énergie électrique, le Mtep l'étant davantage au
regard d'énergies stockables (dont les énergies fossiles…)
2ème remarque:
La colonne de gauche détaille
les "énergies primaires" qui sont mobilisées en vue de leur
consommation (détaillée en colonne de droite) c'est-à-dire que, pour
l'essentiel, ces énergies ne sont pas produites sur le sol national.
3ème remarque:
De la nécessité de définir ce
qu'est une énergie primaire, c'est-à-dire une énergie naturellement présente
dans l'atmosphère (énergie éolienne, solaire) à la surface de la terre
(hydraulique, biomasse) ou dans la croute terrestre (énergies fossiles,
uranium). L'énergie électrique n'est donc pas une énergie primaire,
c'est un vecteur d'énergie qu'il faut produire par transformation
d'énergies primaires.
Constats sur
le bilan 2021:
Avec 2856 TWh, et par rapport
au bilan 2019, la France a mobilisé 5%
d'énergies primaires en moins, dont 9% d'énergies fossiles en moins (à 1325
TWh) 5% d'énergie nucléaire en moins (à 1150 TWh) et 10% d'énergies renouvelables
en plus à 380 TWh.
Dans le même temps, elle a
consommé 1778 TWh, sensiblement la même quantité qu'en 2019.
De même la consommation d'énergies fossiles sous forme énergétique
reste à ~ 82 Mtep voisine des 85 Mtep de 2019. L'effort, à fournir,
pour le remplacement de ces énergies fossiles reste donc du même ordre, mais
varie en fonction de l'usage final qui en est fait. Ainsi les transports,
premiers consommateurs d'énergie à 501 TWh,
dépendent des énergies fossiles pour 91% de ce chiffre…
On reviendra sur ces
différences d'usage pour expliciter la stratégie de transition à mettre en
œuvre.
2. le bilan 2021 de
production d'énergies renouvelables
Même si cette production
nette augmente
de 10% par rapport à 2019, les énergies renouvelables continuent de ne
contribuer que pour 12% (~ 345 TWh) des ressources primaires mobilisées avec
une répartition en nature de ces énergies évoluant comme explicité en figure 2.
Fig 2. Répartition des énergies renouvelables dans le
mix primaire
Cette répartition est plus
instructive si l'on agrège ces différentes sources selon 5 grandes classes par
ordre décroissant d'importance:
-
la
biomasse solide: 131 TWh soit 4,5% du mix primaire
-
les
énergies renouvelables électriques: 111 TWh (3,9%)
-
les
pompes à chaleur: 41 TWh (1,4%)
-
biocarburants
& biogaz: 38 TWh (1,3%)
-
autres
(géothermie…): 24 TWh (0,9%)
En d'autres termes, en
séparant les énergies renouvelables "électriques" par nature que sont
l'hydraulique, l'éolien et le solaire photovoltaïque (total: 111TWh), les énergies
renouvelables "thermiques" continuent d'être la première source d'énergies
renouvelables (à 234TWh) soit 8,2% du mix primaire. Et si l'on retranche des énergies
renouvelables électriques la part de l'hydraulique (~ 59 TWh)
la somme de l'éolien et du solaire photovoltaïque reste inférieure à 2% de ce
mix.
Au-delà des limitations
intrinsèques à ces deux sources d'énergie déjà vues en leur temps,
quelles sont les avancées significatives à espérer de ces dernières?
L'énergie éolienne ou la course au gigantisme:
On avait vu que la puissance
unitaire installée des éoliennes était le principal obstacle à la récolte de
masse de l'énergie des vents. La figure 3 montre l'évolution récente ainsi que
celle projetée à l'horizon 2030 de cette puissance. On y voit que, au-delà de
la technologie mature en 2021 (12 MW unitaires pour une hauteur de 220 m), la prochaine
génération d'éolienne pourrait friser la taille de la tour Eiffel…il
n'est pas du tout certain que le déploiement de cette technologie à grande
échelle soit accepté, sur terre, par les populations concernées…
Fig3. Évolution des caractéristiques des éoliennes
Un tout autre déploiement
mérite qu'on s'y attarde: celui de l'off shore pour lequel
l'installation loin des côtes de ces grandes éoliennes pourrait se
révéler d'autant plus intéressante que le facteur de charge,
de l'ordre de 25% pour l'éolien terrestre pourrait monter à 50% dans ce cas.
A cet égard la mise en service fin 2022 de la "ferme éolienne" de St.
Nazaire
est une expérience à suivre tant en termes de productivité que d'acceptabilité
sociale.
L'énergie solaire Photovoltaïque ou la
chasse au foncier:
Les retours d'expérience sur
les installations photovoltaïques réalisées permettent d'établir un ordre de
grandeur pour la valeur moyenne annuelle du facteur de charge de cette
technologie, variant de 10% en Région Nord/Pas-de-Calais à 15% en Région PACA.
Dans ces conditions, et en se rappelant la valeur moyenne annuelle de
l'Irradiation solaire Globale Horizontale en France métropolitaine,
une puissance Photovoltaïque installée de 1 GW occupera une surface moyenne
de l'ordre de 1000 ha,
une fois intégrés les panneaux solaires, les infrastructures de support, de
transformation et de raccordement au
réseau électrique national.
Avec le retour ci-dessous sur
la biomasse, on reviendra sur ce problème d'occupation des sols en France. En
attendant il apparaît raisonnable de cantonner autant que faire se peut
l'installation du photovoltaïque aux sols déjà artificialisés (toitures,
parkings…). En tout état de cause, il faudra rester vigilant sur le
développement de l'agrivoltaïsme
qui, exploitant le faible coût du foncier agricole, pourrait inciter les
agriculteurs à se détourner de leur activité première: la production de
nourriture…
Energie fatale ou pilotable?
Une précision tout d'abord:
Pour un
générateur de puissance installée P, dire que son facteur de charge pendant une durée D est de - par exemple
- 20%, c'est dire que ce générateur a fourni en moyenne 20% de sa
puissance P pendant cette durée de temps. En d'autres termes, c'est comme
si le générateur était à l'arrêt durant 80% du temps, et fonctionnait
à pleine puissance pendant les 20% de temps restant. (Suis je clair?)
Compte tenu de cette précision, dire, par exemple, que le facteur
de charge moyen du solaire en Région PACA est de 15%, c'est comme si les
panneaux ne délivraient aucun courant durant 85% du temps. De même, un facteur de
charge de 25% pour les éoliennes terrestres, c'est comme si ces éoliennes étaient
arrêtées 75% du temps. On peut résumer ce problème par la question commune à
ces deux technologies: "que fait-on par les nuits sans vent?"
Pour cette raison, ces sources d'énergie sont dites fatales car
dépendant de facteurs indépendants de la volonté humaine.
En supposant solaire photovoltaïque
et éolien comme uniques sources d'énergie, un dispositif de secours doit
prendre la relève durant les absences de production sous la forme d'une source
indépendante des conditions météo: une telle source est dite pilotable;
il peut s'agir:
-
d'une
centrale hydroélectrique…à condition que la pluviométrie ait été suffisante
dans l'intervalle pour alimenter la retenue d'eau ou le débit fluvial: l'hydroélectricité
est un peu fatale elle aussi!
-
d'une
centrale électrique traditionnelle fonctionnant aux énergies fossiles (charbon,
pétrole, gaz)ce qui va à l'encontre de
l'objectif initial de "sortir des énergies fossiles"…
Et le retour d'expérience en
provenance d'Allemagne, illustré en figures 4 et 4bis, montre qu'un
investissement massif en énergies renouvelables électriques ne diminue pas la
nécessité d'investir simultanément dans de telles centrales traditionnelles.
Fig.4 Allemagne: l'investissement massif en énergies
renouvelables électriques…
Fig.4bis…n'a
pas diminué la dépendance en 'pilotables'
3. Alternative: le
stockage de l'énergie
Le principe:
Stocker une partie de
l'électricité produite quand il y a du vent et/ou du soleil, pour la restituer
dans l'éventualité contraire. De plus, il faut qu'à chaque instant la puissance
électrique produite – somme des puissances des générateurs mis en œuvre – soit
égale à la puissance consommée – somme des puissances des équipements
utilisateurs – au risque, sinon, d'un "décrochage" du réseau et d'un black
out généralisé à son ensemble.
Quantifier la puissance de
stockage destinée à pallier un déficit temporaire (intermittence) de production
relève d'une étude multi-paramètres
dépassant le cadre du présent article. On se contentera ici d'une approche heuristique
en remarquant que le stockage est destiné à s'affranchir de son alternative: la
mise en œuvre de centrales pilotables. Dès lors, l'expérience allemande suggère
que la puissance de secours soit du même ordre de grandeur que la puissance
nominale à secourir. En d'autres termes, il sera prudent d'accompagner
l'installation de 1 GW d'énergies renouvelables électriques avec 1 GW de
puissance de stockage.
Problème:
On ne sait pas stoker l'électricité
en quantités appréciables.
Ce stockage doit donc être précédé d'une transformation en une autre forme
d'énergie stockable, sachant que cette transformation ne se fera pas sans
perte, c'est à dire que le rendement de conversion sera un paramètre déterminant du choix de
l'énergie stockable retenue. Cette énergie pouvant être:
-
mécanique,
dans une Station de Transfert d'Energie par Pompage (STEP)
-
chimique,
dans une batterie
-
voire
un autre vecteur d'énergie, par exemple l'hydrogène…
On reviendra plus loin sur la
problématique spécifique à l'hydrogène.
Pour la conversion en énergie
mécanique, la figure 5 explicite le fonctionnement d'une STEP, c'est à dire le
pompage d'une masse d'eau de l'aval vers l'amont (stockage) puis turbinage de
cette masse de l'amont vers l'aval (restitution), avec un rendement de 70 à 85%.
Ce procédé largement utilisé pour réguler la production heures-pleines /
heures-creuses des centrales électronucléaires présente l'inconvénient de
nécessiter des sites à dénivelé conséquent: la puissance totale actuelle des
STEP en France est ainsi de 7GW, la plus puissante (1,8 GW) étant située dans l'Isère
(fig5bis).
Des extensions sont en cours
ou en projet sur des sites hydroélectriques existants
tandis que des études sont menées visant le couplage des futurs champs éoliens
marins à des STEP côtiers. On peut toutefois s'interroger sur le devenir de ces
projets infiniment plus conséquents que la modeste retenue de Sivens qui a
suscité les oppositions que l'on connaît…
Fig5. Schéma d'une STEP
Fig5bis. STEP de Grand-Maison (Isère)
Stockage
sur batteries (énergie chimique):
La technologie actuelle la
plus efficace est celle basée sur la migration, entre les deux électrodes,
d'ions de lithiumau
sein d'un électrolyte complexe
et qui ne "pèse" que ~ 7kg par kWh stocké contre ~ 20kg pour la
traditionnelle batterie au plomb, tandis que le rendement peut atteindre 90%
dans des conditions opérationnelles optimales
contre 30 à 50% pour le plomb.
La figure 6 explicite le
processus de charge/décharge de la batterie lithium tandis que la figure 7
replace cette technologie en comparaison aux autres technologies de batterie,
tant en termes de poids au kWh qu'en capacité de stockage par unité de volume.
Fig6. Charge & décharge d'une batterie Li-ION
Fig7. Caractéristiques des différentes technologies de
batterie
Pour autant, la technologie
lithium est-elle de nature à résoudre le problème de secours aux énergies
renouvelables électriques fatales?
Considérons 1 GW installés d'énergies
renouvelables électriques que nous souhaitons secourir durant une heure
"de nuit sans vent": il aura fallu stocker au préalable 1 GWh soit
l'équivalent de13000 batteries de voiture Tesla Model S75 chargées à 100% de
leur capacité unitaire de 75kWh…
Cet exemple peut servir à illustrer
le concept de Vehicule to Grid (V2G) proposé pour l'utilisation des
batteries de voitures à l'arrêt
en temps que secours des énergies renouvelables électriques fatales. Avec
l'hypothèse d'un parc national de 16 millions de véhicules électriques à
l'horizon 2035, on disposerait ainsi d'un secours potentiel de 1,2 TWh sous
condition que l'ensemble du parc soit à l'arrêt avec la totalité des batteries
chargées à 100%. Bien entendu, la situation de tous les jours sera autre, avec
seulement une fraction du parc à l'arrêt et en capacité de restituer au réseau
une partie de sa charge…
Sur ces hypothèse, l'étude
conjointe RTE-AVEREmontre
que, sur la base de 3% de véhicules électriques raccordés en V2G, ce système pourrait
constituer un stockage de l'ordre de 35 GWh à condition de piloter la recharge
des véhicules au moyen d'incitations économiques.
Quelle
capacité industrielle pour ce faire?
Les hypothèses ci-dessus
reposent sur la croissance supposée du parc national de 2 millions de véhicules
électriques par an à 76 KWh moyens par batterie, soit une capacité de
production de batteries de ~ 150 GWh /an, ce qui suppose un développement
industriel conséquent alors que la capacité européenne en 2018 culminait à 7 GWh
/an.
Ce constat est à la base de
l' Important Project of Common Interest (IPCEI) sur les batteries, lancé
par l'UE à hauteur de 1,5 milliards d'euros.
Cet "Airbus de la batterie" se concrétise au niveau national par les
annonces récentes de création de 4 "gigafactories"
localisées dans les Hauts-de-France à
Dunkerque (2 usines), Douvrin et Douai dont les productions combinées
pourraient atteindre les 150 GWh/an à l’horizon 2030.
Ce développement industriel ne
pourra éluder le problème de disponibilité des matières premières, tout
particulièrement des métaux "rares" dont la filière lithium est
grosse consommatrice. Ainsi l'Agence Internationale de l'Energie (AIE) estime,
au plan mondial, que d'ici 2040
l'hypothèse du transport "tout électrique"
conduirait à multiplier par 42 la demande en lithium, par 21 celle en cobalt,
par 19 celle en nickel ainsi que la demande en graphite par 25 et la demande en
terres rares par 7…
L'analyse géopolitique de ces
approvisionnements dépasse les limites du présent article et devrait être
effectuée dans le cadre du Thème N°2 (indépendance énergétique) telle que
décrite précédemment.
On se contentera de remarquer ici que, compte tenu de l'état actuel des
réserves prouvées de lithium, la constitution d'une "OPEP du lithium"
n'est pas à exclure, qui pourrait rebattre considérablement les cartes de la
viabilité du "tout électrique"
4. retour sur la
biomasse: quelles limites?
En 2021, la biomasse demeure
la première énergie renouvelable dans le mix primaire avec 170 TWh – ou 14,6
Mtep – d'énergie mobilisée, soit 5,9% du total d'énergies primaires.
Par rapport à notre analyse de 2019,
des précisions doivent être apportées sur les limites de cette source d'énergie
au regard de l'objectif d'abandon des 82 Mtep d'énergies fossiles à remplacer
comme vu plus haut. Ces limites porteront:
-
sur
la biomasse solide, presque totalement constituée de "bois-énergie"
-
sur
la biomasse liquide au travers des biocarburants
-
sur
la biomasse gazeuse au travers du biométhane
Possibilités
et limites du bois-énergie
Les données actualisées sur
la forêt française
font état de 17 Mha boisés (~31% du territoire national) en expansion au rythme
de 89 kha/an. La production annuelle moyenne sur la décennie écoulée ressort à
89 Mm3, limite supérieure de prélèvement si l'on veut se restreindre à la
partie renouvelable de forêt, gage de la neutralité carbone recherchée.
Le prélèvement annuel moyen,
loin de cette limite, ressort à ~50 Mm3, l'entrave, d'ordre économique, au
développement de cette filière étant du fait que 75% de la forêt est de statut
privé.
La figure suivante résume la
"problématique forêt" telle qu'elle se pose au niveau européen,
avec une conclusion d'ensemble répliquée en France, savoir que le bois-énergie
représente la moitié des prélèvements:
Fig8. Les flux forestiers en Europe en millions de m3
(données 2010)
On brule donc la moitié de ce
que l'on prélève, par opposition au bois d'œuvre et au bois industriel destinés
à des usages non énergétiques. Bien noter que, comme schématisé sur la figure
9, le bois-énergie est de relative faible valeur marchande.
Il représente cependant 96% de la biomasse solide
soit 10,8 Mtep en 2021, correspondant à ~43 Mm3 sur la base de l'équivalence
énergétique moyenne du bois.
Fig9. Schéma d'utilisation de l'arbre adulte
Ce dernier chiffre, rapproché
du 50% des prélèvements annuels de 50Mm3 indique que l'on brule beaucoup plus
que du bois renouvelable: il s'agit en particulier de bois "en fin de
vie" (vieux meubles, récupération de démolition…), mais aussi du bois-énergie
importé.
En tout état de cause le bois-énergie
renouvelable est limité par le montant de la disponibilité brute de 89 Mm3,
soit l'équivalent de 22,2 Mtep. Augmenter de façon significative le bois-énergie
ne peut donc se faire qu'en accroissant la surface plantée en forêts, ce qui
revient à faire un arbitrage sur l'occupation des sols.
Quelle
occupation des sols pour les forêts?
Par comparaison avec la
surface forestière, la Surface Agricole Utilisée (SAU) couvre 29 Mha ou 54% du
territoire: la France demeure un grand pays agricole…
Cette SAU se subdivise elle-même
en terres arables (~13,5 Mha), prairies temporaires (~4,9 Mha) et permanentes
(~7,7 Mha), cultures pérennes (~1Mha: vergers, vignes…) et autres SAU (~1,9Mha:
vergers familiaux, jardins…). Toutes ces terres ne sont pas égales en capacité
de séquestration du carbone comme l'illustre la figure suivante établie par le
GIEC
Fig10. Comparaison sols/végétation des séquestrations
moyennes de C
(en tonnes de C par ha)
L'impératif de
"neutralité carbone" préalable à l'utilisation énergétique de la
biomasse nous impose de ne convertir en forêts que les seules surfaces
affichant une moindre séquestration totale (sols +
végétation) que les 150 tonnes/ha réalisés par les "forêts
tempérées": on voit que, dans notre "climat tempéré" cela n'est
possible que pour les seules "terres de culture", encore faut-il en
retrancher les "cultures pérennes" et "autres SAU"
difficilement reconvertibles. La conversion ne peut donc concerner que les
seules terres arables,
soit une surface maximum de 13,5 Mha inférieure aux 17 Mha de la forêt
actuelle…on n'arriverait donc pas à doubler le volume de bois-énergie même en
supprimant toutes les cultures!
A défaut de conversion massive
des terres arables, on peut rendre ces dernières plus productives de bois au
moyen de l'agroforesterie: les expérimentations conduites par l'INRAE
permettent ainsi de conclure que la conversion de 10% des terres arables d'ici
à 2050 permettrait la production de 200 Mm3 étalée sur les 15 ans de croissance
moyenne des arbres, permettant de compenser, partiellement, l'importation de bois-énergie.
Les
biocarburants: manger ou conduire, il faut choisir
Même si, au plan européen, la
figure suivante montre qu'il existe une marge considérable de production des
cultures énergétiques, on
atteint rapidement au plan national la limite acceptable de transformation des
cultures en biocarburants.
Fig11. Surface potentielle de cultures énergétiques en
Europe
(carré rouge en bas à droite: surface actuelle en 2015)
Ainsi des biocarburants
"de 1ère génération" produits selon deux filières:
-
le
bioéthanol produit par fermentation des sucres et incorporé à l'essence en
proportions diverses (E5 E10 E85):
Fig12. Filière du bioéthanol de 1ère
génération
-
le
biogazole obtenu par estérification des huiles végétales et incorporé de même
aux gazoles commerciaux (B7 B10 B30) ou utilisé pur (B100) dans des moteurs adaptés
Fig13. Filière du biogazole de 1ère
génération
Ces biocarburants ont en
commun de mobiliser des ressources alimentaires.
Le nécessaire arbitrage alimentation/biocarburants a conduit l'UE à formaliser
la directive Indirect Land Use Change (ILUC) fixant, dans une enveloppe
de 10% d'énergies renouvelables dans les transports, à 7% max la couverture
énergétique au moyen des biocarburants de 1ère génération.
Cette directive encourage
ainsi le développement des biocarburants de seconde génération, pour lesquelles
les matières premières sont des cultures dédiées ou des résidus –
ligno-cellulosiques et non alimentaires –
de cultures (paille, menu-bois…).
Fig14. Filière ligno-cellusose de 2ème
génération
A l'échelle européenne, le
remplacement des énergies fossiles par l'ensemble des biocarburants est fixé par
la Directive RED II et son schéma en escalier
qui résume les objectifs à l'horizon 2030 :
-
14%
de l'énergie des transports assurés par des énergies renouvelables
-
dont
7% max en biocarburants de 1ère génération comme vu ci-dessus
-
et
3,5% minimum de biocarburants "avancés"
Fig 15. Schéma en escalier de la directive RED II
Noter que la France en 2021
se révèle exemplaire: sur les 501 TWh, ou 43,1 Mtep consommés dans les
transports:
-
7%
soit 3 Mtep sont d'ores et déjà couverts en biocarburants de 1ère
génaration
-
2% ou
0,9 Mtep sont couverts en énergies renouvelables électriques,
avec une marge de progression pour atteindre d'ici 2030, les 3,5% de la 3ème
marche du schéma RED II
-
mais
ce qui laisse encore 91% (39,2 Mtep) couverts en énergies fossiles…
Au passage, la France couvre
donc 9% des transports en énergies renouvelables – sur les 10% demandés par la
Directive ILUC – faisant mieux que l'Allemagne en la matière…
Le bio-méthane
ou comment digérer nos déchets
La décomposition des déchets
organiques – à l'abri de l'air – produit du méthane selon deux filières:
-
acidogénèse
avec génération intermédiaire d'acide carbonique
-
acétogénèse
avec génération intermédiaire d'acide acétique
avec dans les deux cas
libération conjointe de CO2…
Au plan pratique, ces
réactions sont réalisées au sein d'un "digesteur" (figure 16)
admettant en entrée les déchets organiques – produits par l'agriculture,
l'élevage, les industries agroalimentaires ainsi que les collectivités – pour
donner en sortie un biogaz pouvant être utilisé en production jointe
d'électricité et chaleur ("cogénération")
et une masse solide ("digestat") qui restitue l'azote de ces déchets,
neutre au regard des deux réactions chimiques ci-dessus. Ce digestat – presque
équivalent en masse de celle des déchets en entrée – étant utilisable sous
forme d'engrais en épandage ou de matière première pour transformation en compost.
Fig16. Schéma d'une unité de méthanisation
De cette façon, les quelques
360 Mt de déchets produits au plan national pourraient donner à l'horizon 2030
et selon deux scénarios:
-
"tendanciel",
en extrapolation de la dynamique actuelle: 1,5 Mtep en cogénération plus 1,1
Mtep de biométhane
-
"volontariste",
avec incitations financières: 2,6 plus 2,6 Mtep respectivement en cogénération
et en biométhane
En final, de 2,6 à 5,2 Mtep
pourraient ainsi contribuer aux énergies renouvelables via la
récupération/transformation des déchets organiques. Mais les limitations ici
seront sans doute d'ordre sociétal, le transport/stockage de millions de tonnes
de ces déchets n'étant pas sans poser des problèmes de nuisances…
Conclusions
sur la biomasse
Tout en rappelant que la
biomasse reste le premier poste quantitatif des énergies renouvelables, des
gains d'un ordre de grandeur seront difficiles à obtenir sur chacune de ses trois
composantes:
-
un
accroissement substantiel des quantités de bois-énergie supposerait, soit celui
des prélèvements – qui restera entravé par le statut privé des trois quarts des
surfaces boisées – soit celui des surfaces mises en forêts – au détriment de la
production agricole – lequel restera marginal y compris dans un contexte
volontariste de conversion à l'agroforesterie; en tout état de cause, la
contribution énergétique du bois-énergie restera bien en deçà des 22,2 Mtep, équivalent
énergétique de la disponibilité moyenne annuelle générée par les 17 Mha actuels
de forêts
-
même
en visant l'objectif de 14% d'énergies renouvelables dans les transports fixé
par la directive RED II pour l'horizon 2030, et en supposant le doublement à 7%
de la contribution des biocarburants de seconde – voire de troisième
génération – cet objectif ne permettra de contribuer que pour l'équivalent, en
données de 2021, de 6,1 Mtep au bilan énergétique global
-
le
développement du biogaz restera dans une fourchette n'excédant pas 5,2 Mtep
dans le meilleur des scénarios de l'étude Green Gaz Grid
La simple addition des 3
chiffres ci-dessus montre que la biomasse ne saurait à elle seule remplacer les
82 Mtep d'énergies fossiles consommées en 2021…
5. vers le tout
électrique?
Etat actuel
des lieux:
Une mise à jour de la
situation nationale telle que compilée sur le site https://app.electricitymaps.com –
et selon la méthode explicitée
en 2019 – est donnée sur les figures suivantes pour deux dates:
-
5
février 2020, soit tout juste avant le confinement COVID, et dernière année
pleine avant cette pandémie; à 19 heures, la France s'y révèle parmi les pays
les plus "verts" d'Europe, en émettant moins de 100 g de CO2 par kWh produit
Fig17. Productions électriques en Europe le
05/02/2020, 19H00
-
5
décembre 2022 à 17heures, où par contraste, la France y est bien moins verte
du fait de l'arrêt, pour causes diverses de 16 réacteurs électronucléaire sur
56, soit une puissance électronucléaire disponible inférieure à 40 GW pour une
puissance installée de 61GW
Fig18. Productions électriques en Europe le
05/12/2022, 17H00
De façon plus précise, le
document RTE sur le bilan électrique national en 2022
fait état d'une chute, par rapport à 2021, de 82 TWh de production électronucléaire,
que n'arrivent pas à compenser les différentes énergies renouvelables
électriques, que ce soit l'hydraulique (-12TWh: année "sèche"), l'éolien
(+1TWh: année peu venteuse) ou même le solaire (+4TWh) en dépit d'une année
particulièrement chaude…
Le solde négatif n'a été en
fait comblé que par un recours aux centrales thermiques à gaz (+11TWh) et à
l'import de 14 TWh d'électricité depuis des pays tiers
(figure 19)
Fig19. Le déficit de production d'électricité en 2022
L'année 2022 est ainsi
l'illustration du caractère aléatoire d'un recours aux énergies fatales pour
combler un éventuel déficit de production des énergies pilotables.
Prospective à
l'horizon 2050:
Le document "Futurs
énergétiques 2050" de RTE
s'appuie sur la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) de 2020
qui fixe comme objectifs simultanés pour 2050 une réduction de consommation
totale énergétique de 40% pour atteindre 930TWh, et un accroissement de la
production/consommation d'électricité de +1% l'an pour atteindre 510 TWh à
cette date (figure 20).
Fig20. La stratégie nationale bas carbone: objectifs
pour 2050
Le document RTE majore
sensiblement ces objectifs avec une "trajectoire de référence" visant
une consommation totale de ~ 1050 TWh, dont une fraction électrique de ~ 645
TWh, tout en maintenant l'objectif de neutralité carbone et la fin des énergies
fossiles pour cette date.
Le schéma de la figure
suivante résume cette prospective d'évolution des contributions des différentes
sources d'énergie:
Fig21. La trajectoire de référence RTE d'ici à 2050 avec:
-
charbon
& pétrole en noir
-
gaz
en gris foncé
-
biomasse
en gris clair
-
l'hydraulique
en bleu
-
l'électronucléaire
"historique"
en jaune en supposant le retrait progressif des centrales atteignant une limite
d'âge fixée à 60 ans.
La zone rose du graphique
constitue la fraction de production électrique pour laquelle les parts
respectives d'énergies renouvelables électriques et d'électronucléaire
constituent les hypothèses d'étude des différents scénarios envisagés par RTE
sur la composition du "mix électrique". A partir de la trajectoire de
référence vue plus haut, RTE identifie 6 scénarios multi-paramètres proposés à
la décision politique selon le schéma des "coûts complets annualisés à
l'horizon 2060" de la figure suivante avec:
Fig22. Couts complets annualisés d'ici 2060 pour 6
scénarios retenus
-
en
jaune: coûts de l'électronucléaire (historique & nouveau) y compris
"l'aval du cycle",
les provisions pour démantèlement,
-
en
vert: coûts des énergies renouvelables électriques, hors production de
"stockage/déstockage", hors coûts de raccordement au réseau,
-
en
orange: coûts des "flexibilités"
induits par l'usage des énergies renouvelables électriques, y compris la
production renouvelable d'hydrogène,
-
en
bleu foncé: coûts du réseau de transport haute tension, y compris ouvrages de
raccordement et interconnexions,
-
en
bleu clair: coûts du réseau de distribution moyenne tension, y compris ouvrages
de raccordement,
-
en
gris: les recettes d'export escomptées
Analyse coûts/bénéfices
des 6 scénarios:
La figure 22 parle
d'elle-même: pour un objectif de production électrique identique ce sont les
scénarios N2 et N03 qui présentent les deux moindres coûts.
Ces deux scénarios présentent la caractéristique commune de maintenir un fort pourcentage
d'électronucléaire dans le mix électrique final, de 37% pour N2 et 50% pour
N03.
Dans le même temps, ces
scénarios prévoient un développement raisonnablement possible du solaire photovoltaïque
dont la puissance installée serait multipliée par 5 à 6 d'ici 2050, et celle de
l'éolien terrestre de 2 à 2,5. Plus incertain serait le développement de
l'éolien off shore avec une hypothèse visant à construire un nombre conséquent de
"fermes du type St Nazaire": de 44 pour N03 à 72 pour N2…
Par opposition à ces derniers
chiffres, les 4 autres scénarios verraient la construction de 90 à 124 fermes
off shore, l'installation de 25 à 35 mille éoliennes terrestres et la
mobilisation de 130 à 250 milliers d'ha de surfaces agricoles pour leur
transformation en "fermes solaires"…
6. et l'hydrogène
dans tout ça?
Annoncé à grand renfort
médiatique le Plan Hydrogène
français, finalisé à hauteur de 7,5 milliards d'euros présente
ce vecteur d'énergie comme le support incontournable de "l'énergie verte"
de demain.
Qu'en est-il exactement?
On a vu que l'hydrogène sous
forme gazeuse étant absent de la
biosphère, il faut commencer par
le produire à partir de composés chimiques de l'hydrogène, heureusement
abondants sous forme d'énergies primaires que sont:
-
les
hydrocarbonates donc la biomasse ou les énergies fossiles,
-
l'eau,
recouvrant sous forme d'océans 71% de la surface du Globe
Constat:
95% de l'hydrogène produit
industriellement l'est actuellement par vaporeformage du méthane qui
produit 9 tonnes de CO2 pour 1 tonne d'hydrogène, selon l'équation globale:
méthane + eau + chaleur → CO2 + H2
Si l'on veut être sérieux
avec l'objectif de sortie des énergies fossiles, il convient de sortir
également de ce procédé, au profit de la seule alternative actuellement
possible, savoir l'électrolyse de
l'eau.
Electrolyse de
l'eau: les faits & les mythes:
"Craquer" la
molécule d'eau (H2O), particulièrement stable, pour en séparer l'hydrogène de
l'oxygène requiert une quantité appréciable d'énergie: 241 kiloJoules pour
obtenir 2 grammes
d'hydrogène, soit ~33,5 kWh par
kg d'hydrogène libéré,
que l'on résumera, de façon aisément mémorisable:
5 kWh donnent par électrolyse ~ 1000 litres d'hydrogène
en prenant en compte le
rendement actuel d'un électrolyseur: ~60%.
Cependant, on n'imagine pas
le stockage et le transport de ce m3 de gaz, plus léger que l'air, dans un
ballon flottant au bout d'une corde! Pour le stocker et le transporter
commodément il faudra:
-
soit
le comprimer: la norme industrielle actuelle est de 700 bars,
réduisant ce m3 à 22
litres, qu'il convient de renfermer dans un réservoir
suffisamment solide pour résister à cette pression…au
passage, cette compression sera effectuée moyennant 15% d'énergie
supplémentaire
-
soit
le liquéfier: à – 253°C,
ce m3 n'occupera plus que 1,3
litres...avec un nouveau coût d'énergie supplémentaire de 35%
En final, des 5 kWh initiaux
dépensés dans ce processus, on ne récupérera que l'équivalent de 2,55 kWh après
compression ou 1,95 kWh après liquéfaction.
Un usage de l'hydrogène
obtenu par électrolyse de l'eau suppose la disponibilité d'une quantité d'énergie électrique de 2
à 2,5 fois l'énergie finale escomptée.
De la couleur
d'un gaz incolore
Les media, encore eux, se
délectent de l'expression "hydrogène vert" c'est-à-dire dont l'usage
ne produirait aucun GES.
On a déjà vu que ce ne
pourrait être de l'hydrogène obtenu par vaporeformage.
Quant à l'hydrogène issu de l'électrolyse, cette appellation ne saurait être
valide qu'en supposant "verte" l'électricité utilisée.
Le schéma du GIEC, rappelé en
figure suivante et déjà explicité en son temps,
montre qu'aucune source d'énergie primaire transformée en électricité n'est
totalement "verte", si l'on intègre les émissions de GES produites
par la construction/démantèlement des installations de production
correspondantes.
Fig23. Emissions de GES par les énergies primaires
(en grammes de C02 par kWh produit)
Si l'on définit à présent
comme "verte" une source d'énergie ne produisant pas de GES en
exploitation, seules l'électronucléaire et les énergies renouvelables
électriques se qualifient…avant le raccordement des installations
correspondantes au réseau électrique national, car alors il est physiquement
impossible de distinguer la "couleur" des électrons utilisés en
final!
Stockage
de l'hydrogène en tant qu'énergie de secours
Comme vu plus haut, l'hydrogène
peut, de façon conceptuelle, remplacer STEP ou batteries comme solution de
stockage des crêtes de production d'énergies renouvelables électriques pour
assurer le secours de ces dernières durant leurs périodes d'interruption.
Dimensionner la puissance d'électrolyseurs nécessaire suppose une étude prenant
comme hypothèse le seuil à partir duquel cette "production de crête"
doit être délestée du réseau électrique pour alimenter ces électrolyseurs.
Semblable étude, portant sur
le seul cas de l'éolien
montre qu'avec un seuil fixé au quart de la puissance éolienne installée, les
électrolyseurs ne recevraient, sur une période étudiée de 7 mois
que 11% de l'énergie produite; et tenant compte du rendement de la chaine globale:
Electricité produite → stockée → restituée
on ne récupérerait que 3,8%
de cette énergie, un rendement global beaucoup moins élevé que celui vu avec
les batteries au lithium.
Autres
problématiques soulevées par l'usage de l'hydrogène
D'autres problématiques
méritent d'être discutées qui dépassent le cadre de cet article. Citons
notamment:
-
la
stratégie de l'Allemagne et de son "plan hydrogène" à 9 milliards
d'euros, pour sortir enfin des énergies fossiles, en particulier du gaz russe
sous embargo depuis l'invasion de l'Ukraine,
-
le
rôle de lobby exercé par les 27 groupes industriels membres de l'Association française
pour l'hydrogène et les piles à combustible (AFHYPAC),
dans la décision du plan français et les modalités de sa mise en œuvre,
-
l'IPCEI
Hydrogène décidé par l'UE à
l'initiative conjointe de France et Allemagne, son domaine d'application, son
recouvrement potentiel avec l'IPCEI Batteries vu plus haut
-
l'usage
de l'hydrogène dans les "piles à combustible",
et les problèmes de technologie, de matières premières qu'elles posent
-
son
usage dans les transports qu'ils soient légers (voiture individuelle) ou lourds
(camions, ferroviaire)
et les problèmes de réapprovisionnement en cours de route
-
surtout,
les promesses ouvertes par la découverte récente d'hydrogène natif dans
certains bassins miniers seraient de nature à rebattre entièrement les cartes
de cet élément qui passerait alors du statut de vecteur d'énergie à celui
d'énergie primaire
Compte tenu de leur
importance, ces différentes problématiques feront l'objet d'un autre article
sur l'Economie de l'hydrogène. En tout état de cause, et compte tenu du
faible rendement global actuel de la chaine électricité → hydrogène →
électricité, un usage massif de ce vecteur d'énergie dans la transition
énergétique – dont l'objectif reste, rappelons le, la suppression des énergies
fossiles – ne peut s'envisager sans un recours non moins massif à la production
d'énergie électrique décarbonée.
Et en
guise de conclusions
De ce qui précède, une
nécessaire stratégie se dégage pour assurer la neutralité carbone – et donc
l'arrêt, ou le ralentissement de la dégradation climatique – à l'horizon 2050:
-
mettre
en œuvre la stratégie nationale bas-carbone (SNBC), avec d'importantes
conséquences en termes de nouveaux usages de l'énergie,
-
réussir
la conversion de la production électrique afin d'assurer les besoins exprimés
par ces usages
Comment assumer
la SNBC
Le choix implicite fait de
l'abandon pur et simple des énergies fossiles à l'horizon 2050, conduit à un
impératif d'économie d'énergie – de l'ordre de 950 TWh (ou 82 Mtep) en données
2021 – supposant une transformation profonde des usages de cette énergie. La
part d'économie à effectuer dans chaque secteur d'usage se déclinant de la
façon suivante:
-
dans
les transports: tenant compte des 9% d'énergies renouvelables déjà utilisés
pour ce secteur, les 91% restants, consommés en énergies fossiles, devront être
économisés, soit ~ 456 TWh ou 39,2 Mtep
-
dans
le résidentiel, il faudra économiser, surtout sous forme de moindre chauffage ~ 197 Twh ou 16,9 Mtep
-
l'industrie
pour sa part devra économiser dans ses différents procédés de production ~ 156
TWh ou 13,4 Mtep
-
dans
le tertiaire, ~ 104 TWh ou 8,9 Mtep devront être économisés essentiellement sur
les postes chauffage/climatisation
-
l'agriculture
et la pêche enfin, devront économiser ~ 37 TWh ou 3,2Mtep, essentiellement sur leur
motorisation
Ces économies ne pourront
se faire sans de profondes transformations sociétales.
Ainsi des transports, qui
pour le moment font la part belle à la route, avec 77% du trafic total contre
10% pour le rail.
Tenant compte du fait que le rail coûte 11 fois moins de grammes équivalents
pétrole (gep) par voyageur.km que la route,
un développement conséquent du trafic ferroviaire devra être assuré si l'on
veut atteindre ces objectifs d'économie.
A terme, il faudra peut être
envisager de limiter la voiture individuelle a du "cabotage routier",
restreint à quelques dizaines de km autour du lieu de résidence, le rail se
substituant à la route au-delà.
Ceci ne pourra être accepté que si les compagnies de transport ferroviaire
densifient leur offre de trafic d'une part, imaginent et proposent de nouveaux
services d'autre part (bagages lourds accompagnés, synergie de mobilités…).
Pour le résidentiel, il
faudra achever la réhabilitation du bâti afin que le bilan thermique de chaque
habitation atteigne, autant que faire se peut, la "classe A" du
Diagnostic de Performance Energétique, voire atteindre les normes de "bâti
à énergie positive" pour les nouvelles constructions.
Un effort semblable devra
être fait dans les établissements du secteur tertiaire, avec une attention
particulière au bilan énergétique des équipements de l'économie numérique.
Dans les industries grosses
consommatrices d'énergie (métallurgie, pétrochimie…) l'innovation devra porter
en priorité sur la définition et la mise en œuvre de nouveaux procédés
d'extraction, de production et transformation des matériaux.
Enfin, on a vu que toute
révision des termes de l'occupation des sols entrainée par la nécessaire
transition énergétique ne pourra se faire sans une implication active du monde
agricole. La valeur du foncier agricole, en particulier ne saurait être la variable d'ajustement pour l'implantation
massive d'éoliennes ou de fermes photovoltaïque.
Conversion de
la production électrique
Si l'on se tient à la
"trajectoire de référence" de l'étude RTE
pour l'évolution de la consommation électrique – 645 TWh en 2050 – il convient de
privilégier l'un des scénarios qui maintiennent un socle d'électronucléaire
conséquent, comme seule garantie:
-
de
moindres risques techniques et sociétaux, vis-à-vis de ceux basés sur un choix
100% énergies renouvelables électriques,
-
d'une
efficacité maximisée en termes de flexibilités,
d'émissions de GES, de demandes en matériaux rares ou chers,
-
de
moindres coûts totaux de développement à l'horizon 2060 retenu comme date de
fin de l'électronucléaire "historique"
Parmi ces scénarios, le choix
devrait se porter soit sur le scénario N03 (mix 50/50 entre électronucléaire et
énergies renouvelables électriques) soit sur le scénario N2 (mix 37/63) tels
que décrits dans l'étude RTE, avec une marge de possibles ajustements pour
tenir compte des difficultés/opportunités rencontrées d'ici 2050.
Dans ces conditions, il
devient urgent d'entreprendre les investissements nécessaires au développement
d'une industrie nationale de l'éolien et du photovoltaïque, les
subventions concentrées sur ces deux secteurs devant être redirigées sur l'offre
et non sur la demande comme effectué jusqu'à présent,
lesquelles ont surtout conduit à creuser le déficit commercial avec les pays
leaders sur ces technologies.
Egalement urgents seront les
investissements destinés à l'ensemble de la filière électronucléaire:
-
pour
passer du prototype EPR actuel à des unités industrielles enfin fiabiliséesen
vue de l'installation des 14 unités prévues dans chaque scénario
-
pour
développer la filière industrielle des quelques small modular reactors
(SMR) proposés en complément de ces EPR de seconde génération
Et pour garantir le futur de
l'électronucléaire au-delà de 2060, ces investissements ne sauraient laisser de
coté la R&D de 4ème génération, gage tout à la fois:
-
d'une
solution pérenne au problème des déchets d'électronucléaire
-
d'une
évolution vers une électronucléaire "quasi" renouvelable par la
réutilisation des stocks importants d'uranium "appauvri" accumulés au
cours du dernier demi-siècle
En final, et en attendant
cette "fermeture du cycle du carburant" de l'électronucléaire, il
convient de rappeler que le projet CIGEO
d'enfouissement profond des déchets – avec son moratoire garantissant pour 100
ans la réversibilité de cet enfouissement – constitue la seule solution
actuelle raisonnable au problème des déchets à fortes activité et période
radioactives.
Et tout le reste n'est que
littérature…
Notes et références